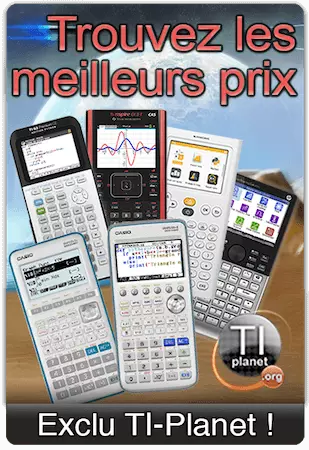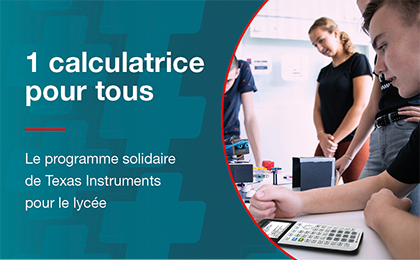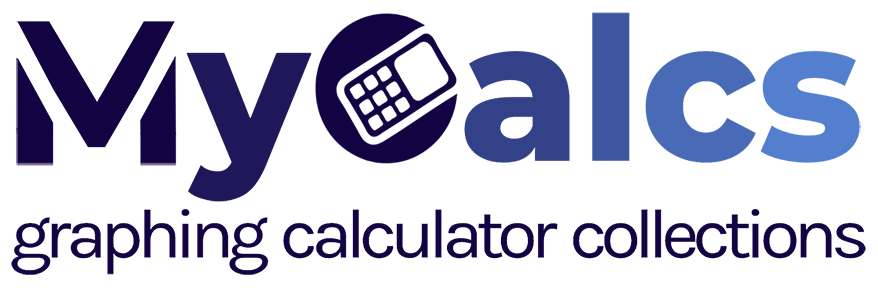mgac bts nrc 2
DownloadTélécharger
Actions
Vote :
ScreenshotAperçu
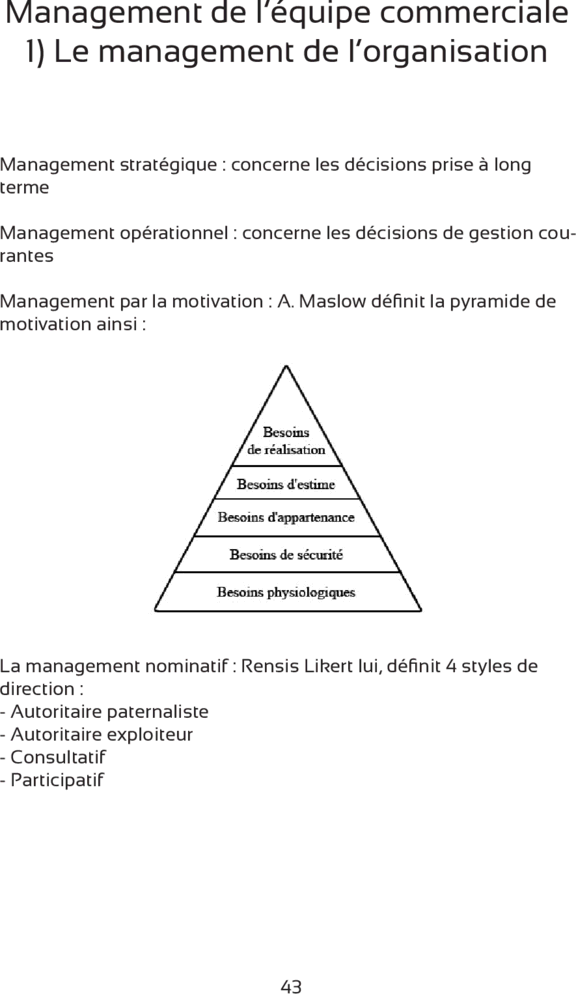
Informations
Catégorie :Category: mViewer GX Creator Lua TI-Nspire
Auteur Author: krozoo
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 28
Taille Size: 2.28 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 04/05/2015 - 14:13:39
Uploadeur Uploader: krozoo (Profil)
Téléchargements Downloads: 131
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : https://tipla.net/a209383
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 28
Taille Size: 2.28 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 04/05/2015 - 14:13:39
Uploadeur Uploader: krozoo (Profil)
Téléchargements Downloads: 131
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : https://tipla.net/a209383
Description
Management de l’équipe commerciale
1) Le management de l’organisation
Management stratégique : concerne les décisions prise à long
terme
Management opérationnel : concerne les décisions de gestion cou-
rantes
Management par la motivation : A. Maslow définit la pyramide de
motivation ainsi :
La management nominatif : Rensis Likert lui, définit 4 styles de
direction :
- Autoritaire paternaliste
- Autoritaire exploiteur
- Consultatif
- Participatif
43
Management de l’équipe commerciale
2) La distribution
Les 3 canaux de distribution existants :
Distribution intensive : cherche à s’implanter dans un maximum de
point de vente pour distribuer le plus possible de produit
Distribution exclusive : limitation du nombre de point de vente dans
une zone. Cela permet au distributeur de ne pas avoir de concur-
rence dans une zone géographique
Distribution sélective : sélection des points de vente afin de garan-
tir la qualité et l’image de marque du produit
44
Management de l’équipe commerciale
3) Les structures commerciales
Structure par produit :
Structure par zone géographique :
Structure par client :
Structure par réseau :
Structure par projet :
45
Management de l’équipe commerciale
4) Les statuts des commerciaux
Un commercial peut-être :
- Salarié
- VRP (voyageur représentant placier) exclusif ou multicartes
- Agent commercial
- Vendeur à domicile indépendant
46
Management de l’équipe commerciale
5) La taille de l’équipe commerciale
Afin de déterminer la taille optimale de force de vente, il faut faire
ces étapes :
- Calcul du nombre de visite à réaliser par an
- Calcul du nombre de visite réalisable par un vendeur par an
- Calcul de la force de vente optimale
Calcul de la force de vente optimale :
47
Management de l’équipe commerciale
6) Le recrutement
Il y a deux étapes pour établir un recrutement :
- Définition du profil de poste (missions, qualification, expérience)
- Recherche du profil du candidat le plus adapté
Recrutement externe : recherche du candidat auprès des collabo-
rateurs
Recrutement interne :
- Annonces (papiers ou télévisé)
- Cooptation (parrainage)
- Démarchage d’étudiant en fin de formation
- Candidatures spontanées
Lorsque vous devez choisir un candidat en fonction de son CV,
faite un scoring :
48
Management de l’équipe commerciale
7) La rémunération
Avantages de la rémunération fixe pour l’entreprise :
- Prévision des dépenses
- Possiblité de confier d’autres tâches que la vente
Avantages de la rémunération fixe pour le commercial :
- Garantie de salaire
- Prévision de la rémunération
Inconvénients :
- Manque de motivation
- Les vendeurs les plus productifs régressent
Rémunération variable :
- Commission
- Prime
Avantages du variable :
- Motive les commerciaux
- Incite la hausse du CA ou/et des marges
49
Management de l’équipe commerciale
8) Les objectifs commerciaux
Éléments d’objectifs quantitatifs :
- Chiffre d’affaires
- Marge
- Quantités vendues
- Nombre de visite/client
- Part de marché
Éléments d’objectifs qualitatif :
- Qualité du reporting
- Image de l’entreprise véhiculée
- Suivi des ventes
- Informations clients
50
Management de l’équipe commerciale
9) La rentabilité de
l’action commerciale
Étapes pour calculer la rentabilité d’une action :
- Définition des charges directes et indirectes
- Calcul de la marge
- Évaluation des résultats de l’action
Charges directes : tout ce qui est directement lié à l’action com-
merciale (ex: fixe et variable du commercial, frais de déplacement)
Charges indirectes : le reste des éléments qui ne sont pas liés
directement à l’action commercial (ex: salaire de la secrétaire,
amortissement du matériel)
Marge brut = Prix de vente - coût de revient des produits vendus
Marge net = Marge brut - coûts commerciaux
Seuil de rentabilité =
Taux de marge sur coût variable =
51
Management de l’équipe commerciale
10) Le travail collaboratif
Travail collaboratif : toutes actions dans le but de partager et
d’échanger au sein de l’entreprise
Outils du travail collaboratif :
- Informatique
- Base de données partagées
- Annuaire des salariés de l’entreprise
- Agenda partagé
- Communication via internet ou intranet
52
Gestion de clientèle
1) Analyse du portefeuille clients
Méthode 20/80
20 % des clients représentent 80 % du chiffre d’affaires
80 % des clients représentent 20 % du chiffre d’affaires
Méthode ABC
Catégorie A : 20 % des clients représentent 80 % du chiffre d’af-
faires
Catégorie B : 30% des clients représentent 15 % du chiffre d’affaires
Catégorie C : 50 % des clients représentent 5 % du chiffre d’affaires
53
Gestion de clientèle
2) Analyse du chiffre d’affaires
Le taux de croissance :
Indice :
Calcul de l’indice des prix :
Euros constants :
CA en euros constants de 2013, voici le calcul :
(763/102) x 100 = 748
CA en euros constants de 2014 :
(854/106,08) x 100 = 805
54
Gestion de clientèle
3) La prévision des ventes
Méthode points extrêmes :
y = ax + b
y = le résultat recherché
a = le montant à multiplier par x
x = l’année recherchée (6 ici)
b = une correction à apporter au calcul de prévision
En remplaçant y et x par les coordonnées des deux points ex-
trêmes, on obtient :
Premier point : 80 = a x 1 + b
Dernier point : 408 = a x 5 + b
Pour résoudre cette équation, il suffit de soustraire l’équation du
premier point au dernier point, soit (2)-(1) :
408 – 80 = 5 a + b – (1 a + b)
328 = 4 a
328/4 = a
a = 82
Il reste à trouver b pour pouvoir déterminer le chiffre d’affaires de
l’année 6.
Il suffit de reprendre la première équation:
80 = 1 a + b
80 = 82 + b
80 – 82 = b = -2
Nous pouvons en déduire l’équation de la droite d’ajustement
linéaire :
y = ax + b = 82x + (-2)
Afin de terminer le CA prévisionnel de l’entreprise en 2013, il suffit
de remplacer x par 6.
y = (82 x 6) – 2 = 492 – 2 = 490
Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2013 est de 490 000 €.
55
Méthode mayer ou double moyenne :
Calcul des coordonnées des points M1 et M2 :
M1 =
x1 = somme des x (années) / nombre de points = 6/3 = 2
y1 = somme des chiffres d’affaires / nombre de points = 500/3 =
166,66
M1 = (x1 ; y1) = (2 ; 166,66)
M2 =
x2 = somme des x (années) / nombre de points = 9/2 = 4,5
y2 = somme des chiffres d’affaires / nombre de points = 748/2 =
374
M2 = (x2 ; y2) = (4,5 ; 374)
Calcul de l’équation de la droite :
Il suffit de poser l’équation y = ax + b mais en remplaçant les x et
les y par les valeurs de M1 et M2
M1 : y1 = ax1 + b soit 166,66 = 2 a + b
M2 : y2 = ax2 + b soit 374 = 4,5 a + b
Il suffit de soustraire M1 à M2.
M2 – M1 =
374 – 166,66 = 4,5 a – 2 a
207,34 = 2,5 a
207,34 / 2,5 = a
82,94 = a
Trouvons maintenant b :
166,66 = (2 x 82,94) + b
166,66 = 165,88 + b
166,66 – 165,88 = b
0,78 = b
La droite d’ajustement est donc :
y = 82,94x + 0,78
y = (82,94 x 6) + 0,78 = 498,42
Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2013 est de 498 420 €
56
Méthode des moindres carrés :
X = année - moyenne
Y = CA en millier d’euros - moyenne
a = somme des X x Y / somme des X² = 836/10 = 83,6
b = moyenne du CA – a x moyenne des années = 249,6 – 83,6 x 3
= 249,6 – 250,8 = -1,2
l’équation de la droite est donc :
y = 83,6 x 6 -1,2 = 500,4
Le CA prévisionnel pour 2013 est de 500 400 €.
57
Prévision saisonnière :
Représentation graphique :
Afin de prévoir le chiffre d’affaires trimestriel de 2013, il faut tout
d’abord calculer les indicateurs de saisonnalité à partir des chiffres
d’affaires réalisés auparavant. Ces indicateurs sont des coeffi-
cients saisonniers.
Lorsque le coefficient est :
- égal à 1 : le trimestre est égal au trimestre moyen
- inférieur à 1 : le trimestre souffre d’une baisse par rapport au tri-
mestre moyen
- supérieur à 1 : le trimestre bénéficie d’une hausse par rapport au
trimestre moyen
58
Calcul de l’année moyenne :
502+550+628 = 1680
1680/3 = 560
calcul du trimestre moyen :
560/4 = 140
détermination des coefficients saisonniers :
Trimestre 1 :
(202 + 210 + 230)/3 = 214
214/140 = 1,53
coefficient saisonnier du trimestre 1 = 1,53
Trimestre 2 :
(150 + 170 + 193)/3= 171
171/140 = 1,22
coefficient saisonnier du trimestre 2 = 1,22
Même opération pour le trimestre 3 et 4 où nous obtenons respec-
tivement 0,44 et 0,81.
Chiffre d’affaires prévisionnel par trimestre :
Si le CA prévisionnel de 2013 est de 500 000 €, il suffit de faire le
tableau suivant :
Le CA prévisionnel sera donc de :
- 198 900 € pour le trimestre 1
- 158 600 € pour le trimestre 2
- 57 200 € pour le trimestre 3
- 105 300 € pour le trimestre 4
59
Gestion de clientèle
4) Analyse du bilan
Actif : ce que possède l’entreprise
Passif : ses ressources propres et endettements
Actif immobilisé : biens destinés à rester dans l’entreprise à long
terme
Immobilisations incorporelles : biens immatériels (ex: marque,
licences, brevets)
Immobilisations corporelles : biens matériels (ex: meubles,
machines)
Immobilisations financières : les titres détenu par les investisseurs
Actif circulant : ensemble des biens destinés à rester moins d’un
an dans l’entreprise
Stock : matière première et marchandise
Créances clients : la somme des dettes que les clients doivent à
l’entreprise
60
Disponibilités : ce sont des fonds disponibles rapidement
La colonne « brut » des actifs représente la valeur d’acquisition des
immobilisations.
La colonne « amortissements et provisions » concerne la
dépréciation des biens, stocks et créances clients.
La colonne « net » donne la valeur actuel car elle prend en compte
la dépréciation.
Il suffit de faire : brut – amortissement et prévisions = net
Définitions des intitulés du passif :
- Passif : coût des ressources présentes dans l’actif.
- Capital : les fonds des actionnaires et des associés de
l’entreprise.
- Réserves : bénéfices qui n’ont pas encore été distribués aux
actionnaires et associés.
- Résultat : la somme de l’enrichissement de l’entreprise avant que
les dividendes ne soient distribuées aux actionnaires et associés.
- Dettes : ensemble des emprunts réalisés auprès des banques et
des autres établissements financiers ainsi que les découverts.
Le bilan comptable est un outil difficile à analyser. C’est pourquoi,
nous établirons un bilan fonctionnel qui se veut plus simple et
structuré de façon à pouvoir analyser l’ensemble des informations.
Le bilan fonctionnel se divise en 3 lignes : les investissements à
long terme, les dépenses à court terme puis la trésorerie.
61
Afin de passer d’un bilan comptable à un bilan fonctionnel il est
nécessaire de compresser certaines informations.
Sur l’actif :
- passer la somme des actifs immobilisés en emplois stables
(colonne «brut» du bilan comptable)
- les stocks, en-cours et créances forment l’actif circulant brut
- la trésorerie active représente les disponibilités ainsi que les
valeurs mobilières de placement
Sur le passif :
- réunir les capitaux propres, les dettes financières (moyen et long
terme), les amortissement et provisions pour former les ressources
stables
- les dettes circulantes représentent les dettes d’exploitation + les
autres dettes
- les découverts représentent la trésorerie passive (concours
bancaires)
62
Analyse du bilan fonctionnel :
Le fond de roulement net global (FRNG)
Le FRNG est le surplus des ressources stables par rapport aux
emplois stables. Le FRNG permet de vérifier que l’entreprise à un
bon équilibre financier : les ressources stables doivent
normalement financer les emplois stables.
Ressources stables – Emplois stables = FRNG
Ressources stables = Capitaux propres – dettes financières
Si le FRNG est supérieur à 0 = l’entreprise dispose d’une marge de
sécurité. Le surplus de ressources peut servir à financer les
besoins de financement à court terme également.
Si le FRNG est inférieur à 0 = entreprise qui a des difficultés de
trésorerie. L’entreprise doit financer ses besoins de financement
à long terme avec des ressources à long terme. Si une entreprise
finance ses besoins à long terme avec des ressources circulantes,
elle s’expose à des difficultés de paiement (ex: remboursement de
dettes fournisseurs).
Le besoin en fonds de roulement net global (BFRNG)
Le BFRNG est le besoin de financement émit par l’exploitation de
l’activité.
Il se calcul ainsi :
Actifs circulants (hors disponibilités) – dettes circulantes (hors
passif de trésorerie) = BFRNG
Si le BFRNG est supérieur à 0 = L’entreprise à un besoin de finan-
cement externe.
Si le BFRNG est inférieur à 0 = l’entreprise se finance elle même et
dispose d’un excédent de ressources.
63
exemple :
BFRNG = 231 000 – 149 600 = 81 400 €
L’entreprise est donc en capacité de se fiancer elle même.
La trésorerie nette
La trésorerie nette permet de connaitre le montant des
disponibilités financières à court terme.
Elle se calcule de cette façon :
Trésorerie nette = FRNG – BFRNG
Exemple :
Trésorerie nette = 124 200 – 81 400 = 42 800 €
Afin d’être sûr de nos résultat du FRNG, BFRNG et de la trésorerie
nette, il suffit de calculer une seconde fois la trésorerie mais de
cette façon :
Trésorerie nette = Actifs de trésorerie – Passifs de trésorerie
Les ratios
Afin de faciliter l’analyse du bilan fonctionnel, il est nécessaire de
calculer plusieurs ratios :
64
Solution à apporter
Selon votre analyse du bilan d’une entreprise, vous pouvez appor-
ter plusieurs solutions selon les difficultés rencontrées :
- Ajuster le FRNG en augmentant les ressources stables (ex: cher-
cher de nouveau investisseur) ou en diminuant les emplois stables
(ex: revendre des machines de production);
- Agir sur le BFRNG en réduisant les stocks, en diminuant les
créances des clients ou en augmentant les dettes fournisseurs.
- Faire appel à un organisme financier pour augmenter la trésorerie
et ainsi financer les dettes à courts termes.
65
Gestion de clientèle
5) Les coûts commerciaux
Coûts directs : tous les coûts que l’on peut avoir sur un produit, un
individu et les actions qu’il mène
Exemples : salaires, charges sociales, frais de déplacement, frais
de relation, frais de formation
Coûts indirects : coûts appliqués à plusieurs produits et actions
Exemple : Soutien de l’activité, coût de l’utilisation de matériel (voi-
ture, stand, publicité sur stand), coûts informatiques (ordinateur,
connexion internet), coûts divers (téléphone, frais de bureau)
Coûts variables : charges qui peuvent varier en fonction de l’acti-
vité
Exemples : achat de marchandises et de matières premières, frais
de port, coûts de production, salaires (commissions) et charges
sociales variables en fonction des ventes
Coûts fixes : charges qui ne varient pas en fonction de l’activité de
l’entreprise. Les coûts fixes sont ceux dépendants des
équipements de l’entreprise
Exemples : les loyers, les intérêts des emprunts, les salaires fixes,
les amortissements
66
Gestion de clientèle
6) La rentabilité
Calcul de l’amortissement :
B = coûts d’acquisition HT – valeur résiduelle
L’amortissement en fonction des avantages économiques se
calcule ainsi : A = B x AAA : AGA
A = amortissement annuel
B = base de l’amortissement (coût d’acquisition HT – valeur rési-
duelle)
AAA = avantage annuel attendu
AGA = avantage global attendu
Tableau d’amortissement d’un véhicule amorti à partir du
01/01/2014 qui est repris par le constructeur automobile 8 ans
après l’utilisation pour une valeur de 3 000 € (valeur résiduelle).
67
Calcul du montant de l’amortissement linéaire :
A=Bxt
A = montant de l’amortissement (annuité)
B = base de l’amortissement (coût d’achat HT – valeur résiduelle
estimée)
t = taux
ex: un véhicule est acheté en Novembre 2014 d’une valeur
de 15 000 €. L’entreprise prévois de l’utiliser sur 5 ans et de le
revendre 2 000 € après l’utilisation (valeur résiduelle).
calcul de l’annuité de 2014 =
(15 000 – 2 000) x 0,20 x (59/360) = 426,11€
0,20 = taux d’amortissement par année (5 ans soit 20 % par an)
59 = nombre de jour d’utilisation avant la fin de l’année
360 = nombre de jour dans l’année
Le taux se calcule donc de la façon suivante : t = 100 / n
exemple : l’entreprise prévoit d’amortir le véhicule sur 5 ans donc
t = 100 / 5 = 20 %
exemple de tableau d’amortissement linéaire :
68
Seuil de rentabilité :
Calcul de la marge sur coût variable :
CA HT – Coûts variables = MSCV
Calcul du résultat : MSCV – Charges fixes = Résultat
Le résultat permet d’établir le compte de résultat (ou compte de
résultat par variabilité) qui trie les coûts par catégorie, montant et
pourcentage.
Voici un exemple de compte de résultat différentiel :
Le résultat peut être positif ou négatif. Si’l est positif c’est que
l’entreprise réalise un bénéfice et dans le cas contraire, une perte.
L’analyse du résultat différentiel permet de trouver le taux de
marge sur coût variable.
Calcul du taux de marge sur coût variable : (MSCV / CA ) x 100
Calcul du seuil de rentabilité :
Le seuil de rentabilité est atteint lorsque la MSCV – coûts fixes = 0
Calcul du seuil de rentabilité à partir du compte
de résultat différentiel : Coûts fixes / TMSCV = SR
Calcul de la transformation du SR en SR en quantité (le nombre de
vente pour atteindre le SR) : SR / PVUHT = SR en quantité
exemple : Le SR d’une entreprise est de 350 000 €. Elle commer-
cialise une formation au professionnel d’un montant de 500 € HT.
350 000 / 500 = 700 ventes minimum pour atteindre le seuil de
rentabilité.
69
Gestion de clientèle
Conseils
Entrez un maximum de formules et de tableau dans votre calcula-
trice avant l’épreuve de MGAC.
Vérifiez les piles de votre calculatrice
N’oubliez pas votre règle pour les tableaux
Donnez la provenance de chaques résultats et de chaques don-
nées utilisées
70
1) Le management de l’organisation
Management stratégique : concerne les décisions prise à long
terme
Management opérationnel : concerne les décisions de gestion cou-
rantes
Management par la motivation : A. Maslow définit la pyramide de
motivation ainsi :
La management nominatif : Rensis Likert lui, définit 4 styles de
direction :
- Autoritaire paternaliste
- Autoritaire exploiteur
- Consultatif
- Participatif
43
Management de l’équipe commerciale
2) La distribution
Les 3 canaux de distribution existants :
Distribution intensive : cherche à s’implanter dans un maximum de
point de vente pour distribuer le plus possible de produit
Distribution exclusive : limitation du nombre de point de vente dans
une zone. Cela permet au distributeur de ne pas avoir de concur-
rence dans une zone géographique
Distribution sélective : sélection des points de vente afin de garan-
tir la qualité et l’image de marque du produit
44
Management de l’équipe commerciale
3) Les structures commerciales
Structure par produit :
Structure par zone géographique :
Structure par client :
Structure par réseau :
Structure par projet :
45
Management de l’équipe commerciale
4) Les statuts des commerciaux
Un commercial peut-être :
- Salarié
- VRP (voyageur représentant placier) exclusif ou multicartes
- Agent commercial
- Vendeur à domicile indépendant
46
Management de l’équipe commerciale
5) La taille de l’équipe commerciale
Afin de déterminer la taille optimale de force de vente, il faut faire
ces étapes :
- Calcul du nombre de visite à réaliser par an
- Calcul du nombre de visite réalisable par un vendeur par an
- Calcul de la force de vente optimale
Calcul de la force de vente optimale :
47
Management de l’équipe commerciale
6) Le recrutement
Il y a deux étapes pour établir un recrutement :
- Définition du profil de poste (missions, qualification, expérience)
- Recherche du profil du candidat le plus adapté
Recrutement externe : recherche du candidat auprès des collabo-
rateurs
Recrutement interne :
- Annonces (papiers ou télévisé)
- Cooptation (parrainage)
- Démarchage d’étudiant en fin de formation
- Candidatures spontanées
Lorsque vous devez choisir un candidat en fonction de son CV,
faite un scoring :
48
Management de l’équipe commerciale
7) La rémunération
Avantages de la rémunération fixe pour l’entreprise :
- Prévision des dépenses
- Possiblité de confier d’autres tâches que la vente
Avantages de la rémunération fixe pour le commercial :
- Garantie de salaire
- Prévision de la rémunération
Inconvénients :
- Manque de motivation
- Les vendeurs les plus productifs régressent
Rémunération variable :
- Commission
- Prime
Avantages du variable :
- Motive les commerciaux
- Incite la hausse du CA ou/et des marges
49
Management de l’équipe commerciale
8) Les objectifs commerciaux
Éléments d’objectifs quantitatifs :
- Chiffre d’affaires
- Marge
- Quantités vendues
- Nombre de visite/client
- Part de marché
Éléments d’objectifs qualitatif :
- Qualité du reporting
- Image de l’entreprise véhiculée
- Suivi des ventes
- Informations clients
50
Management de l’équipe commerciale
9) La rentabilité de
l’action commerciale
Étapes pour calculer la rentabilité d’une action :
- Définition des charges directes et indirectes
- Calcul de la marge
- Évaluation des résultats de l’action
Charges directes : tout ce qui est directement lié à l’action com-
merciale (ex: fixe et variable du commercial, frais de déplacement)
Charges indirectes : le reste des éléments qui ne sont pas liés
directement à l’action commercial (ex: salaire de la secrétaire,
amortissement du matériel)
Marge brut = Prix de vente - coût de revient des produits vendus
Marge net = Marge brut - coûts commerciaux
Seuil de rentabilité =
Taux de marge sur coût variable =
51
Management de l’équipe commerciale
10) Le travail collaboratif
Travail collaboratif : toutes actions dans le but de partager et
d’échanger au sein de l’entreprise
Outils du travail collaboratif :
- Informatique
- Base de données partagées
- Annuaire des salariés de l’entreprise
- Agenda partagé
- Communication via internet ou intranet
52
Gestion de clientèle
1) Analyse du portefeuille clients
Méthode 20/80
20 % des clients représentent 80 % du chiffre d’affaires
80 % des clients représentent 20 % du chiffre d’affaires
Méthode ABC
Catégorie A : 20 % des clients représentent 80 % du chiffre d’af-
faires
Catégorie B : 30% des clients représentent 15 % du chiffre d’affaires
Catégorie C : 50 % des clients représentent 5 % du chiffre d’affaires
53
Gestion de clientèle
2) Analyse du chiffre d’affaires
Le taux de croissance :
Indice :
Calcul de l’indice des prix :
Euros constants :
CA en euros constants de 2013, voici le calcul :
(763/102) x 100 = 748
CA en euros constants de 2014 :
(854/106,08) x 100 = 805
54
Gestion de clientèle
3) La prévision des ventes
Méthode points extrêmes :
y = ax + b
y = le résultat recherché
a = le montant à multiplier par x
x = l’année recherchée (6 ici)
b = une correction à apporter au calcul de prévision
En remplaçant y et x par les coordonnées des deux points ex-
trêmes, on obtient :
Premier point : 80 = a x 1 + b
Dernier point : 408 = a x 5 + b
Pour résoudre cette équation, il suffit de soustraire l’équation du
premier point au dernier point, soit (2)-(1) :
408 – 80 = 5 a + b – (1 a + b)
328 = 4 a
328/4 = a
a = 82
Il reste à trouver b pour pouvoir déterminer le chiffre d’affaires de
l’année 6.
Il suffit de reprendre la première équation:
80 = 1 a + b
80 = 82 + b
80 – 82 = b = -2
Nous pouvons en déduire l’équation de la droite d’ajustement
linéaire :
y = ax + b = 82x + (-2)
Afin de terminer le CA prévisionnel de l’entreprise en 2013, il suffit
de remplacer x par 6.
y = (82 x 6) – 2 = 492 – 2 = 490
Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2013 est de 490 000 €.
55
Méthode mayer ou double moyenne :
Calcul des coordonnées des points M1 et M2 :
M1 =
x1 = somme des x (années) / nombre de points = 6/3 = 2
y1 = somme des chiffres d’affaires / nombre de points = 500/3 =
166,66
M1 = (x1 ; y1) = (2 ; 166,66)
M2 =
x2 = somme des x (années) / nombre de points = 9/2 = 4,5
y2 = somme des chiffres d’affaires / nombre de points = 748/2 =
374
M2 = (x2 ; y2) = (4,5 ; 374)
Calcul de l’équation de la droite :
Il suffit de poser l’équation y = ax + b mais en remplaçant les x et
les y par les valeurs de M1 et M2
M1 : y1 = ax1 + b soit 166,66 = 2 a + b
M2 : y2 = ax2 + b soit 374 = 4,5 a + b
Il suffit de soustraire M1 à M2.
M2 – M1 =
374 – 166,66 = 4,5 a – 2 a
207,34 = 2,5 a
207,34 / 2,5 = a
82,94 = a
Trouvons maintenant b :
166,66 = (2 x 82,94) + b
166,66 = 165,88 + b
166,66 – 165,88 = b
0,78 = b
La droite d’ajustement est donc :
y = 82,94x + 0,78
y = (82,94 x 6) + 0,78 = 498,42
Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2013 est de 498 420 €
56
Méthode des moindres carrés :
X = année - moyenne
Y = CA en millier d’euros - moyenne
a = somme des X x Y / somme des X² = 836/10 = 83,6
b = moyenne du CA – a x moyenne des années = 249,6 – 83,6 x 3
= 249,6 – 250,8 = -1,2
l’équation de la droite est donc :
y = 83,6 x 6 -1,2 = 500,4
Le CA prévisionnel pour 2013 est de 500 400 €.
57
Prévision saisonnière :
Représentation graphique :
Afin de prévoir le chiffre d’affaires trimestriel de 2013, il faut tout
d’abord calculer les indicateurs de saisonnalité à partir des chiffres
d’affaires réalisés auparavant. Ces indicateurs sont des coeffi-
cients saisonniers.
Lorsque le coefficient est :
- égal à 1 : le trimestre est égal au trimestre moyen
- inférieur à 1 : le trimestre souffre d’une baisse par rapport au tri-
mestre moyen
- supérieur à 1 : le trimestre bénéficie d’une hausse par rapport au
trimestre moyen
58
Calcul de l’année moyenne :
502+550+628 = 1680
1680/3 = 560
calcul du trimestre moyen :
560/4 = 140
détermination des coefficients saisonniers :
Trimestre 1 :
(202 + 210 + 230)/3 = 214
214/140 = 1,53
coefficient saisonnier du trimestre 1 = 1,53
Trimestre 2 :
(150 + 170 + 193)/3= 171
171/140 = 1,22
coefficient saisonnier du trimestre 2 = 1,22
Même opération pour le trimestre 3 et 4 où nous obtenons respec-
tivement 0,44 et 0,81.
Chiffre d’affaires prévisionnel par trimestre :
Si le CA prévisionnel de 2013 est de 500 000 €, il suffit de faire le
tableau suivant :
Le CA prévisionnel sera donc de :
- 198 900 € pour le trimestre 1
- 158 600 € pour le trimestre 2
- 57 200 € pour le trimestre 3
- 105 300 € pour le trimestre 4
59
Gestion de clientèle
4) Analyse du bilan
Actif : ce que possède l’entreprise
Passif : ses ressources propres et endettements
Actif immobilisé : biens destinés à rester dans l’entreprise à long
terme
Immobilisations incorporelles : biens immatériels (ex: marque,
licences, brevets)
Immobilisations corporelles : biens matériels (ex: meubles,
machines)
Immobilisations financières : les titres détenu par les investisseurs
Actif circulant : ensemble des biens destinés à rester moins d’un
an dans l’entreprise
Stock : matière première et marchandise
Créances clients : la somme des dettes que les clients doivent à
l’entreprise
60
Disponibilités : ce sont des fonds disponibles rapidement
La colonne « brut » des actifs représente la valeur d’acquisition des
immobilisations.
La colonne « amortissements et provisions » concerne la
dépréciation des biens, stocks et créances clients.
La colonne « net » donne la valeur actuel car elle prend en compte
la dépréciation.
Il suffit de faire : brut – amortissement et prévisions = net
Définitions des intitulés du passif :
- Passif : coût des ressources présentes dans l’actif.
- Capital : les fonds des actionnaires et des associés de
l’entreprise.
- Réserves : bénéfices qui n’ont pas encore été distribués aux
actionnaires et associés.
- Résultat : la somme de l’enrichissement de l’entreprise avant que
les dividendes ne soient distribuées aux actionnaires et associés.
- Dettes : ensemble des emprunts réalisés auprès des banques et
des autres établissements financiers ainsi que les découverts.
Le bilan comptable est un outil difficile à analyser. C’est pourquoi,
nous établirons un bilan fonctionnel qui se veut plus simple et
structuré de façon à pouvoir analyser l’ensemble des informations.
Le bilan fonctionnel se divise en 3 lignes : les investissements à
long terme, les dépenses à court terme puis la trésorerie.
61
Afin de passer d’un bilan comptable à un bilan fonctionnel il est
nécessaire de compresser certaines informations.
Sur l’actif :
- passer la somme des actifs immobilisés en emplois stables
(colonne «brut» du bilan comptable)
- les stocks, en-cours et créances forment l’actif circulant brut
- la trésorerie active représente les disponibilités ainsi que les
valeurs mobilières de placement
Sur le passif :
- réunir les capitaux propres, les dettes financières (moyen et long
terme), les amortissement et provisions pour former les ressources
stables
- les dettes circulantes représentent les dettes d’exploitation + les
autres dettes
- les découverts représentent la trésorerie passive (concours
bancaires)
62
Analyse du bilan fonctionnel :
Le fond de roulement net global (FRNG)
Le FRNG est le surplus des ressources stables par rapport aux
emplois stables. Le FRNG permet de vérifier que l’entreprise à un
bon équilibre financier : les ressources stables doivent
normalement financer les emplois stables.
Ressources stables – Emplois stables = FRNG
Ressources stables = Capitaux propres – dettes financières
Si le FRNG est supérieur à 0 = l’entreprise dispose d’une marge de
sécurité. Le surplus de ressources peut servir à financer les
besoins de financement à court terme également.
Si le FRNG est inférieur à 0 = entreprise qui a des difficultés de
trésorerie. L’entreprise doit financer ses besoins de financement
à long terme avec des ressources à long terme. Si une entreprise
finance ses besoins à long terme avec des ressources circulantes,
elle s’expose à des difficultés de paiement (ex: remboursement de
dettes fournisseurs).
Le besoin en fonds de roulement net global (BFRNG)
Le BFRNG est le besoin de financement émit par l’exploitation de
l’activité.
Il se calcul ainsi :
Actifs circulants (hors disponibilités) – dettes circulantes (hors
passif de trésorerie) = BFRNG
Si le BFRNG est supérieur à 0 = L’entreprise à un besoin de finan-
cement externe.
Si le BFRNG est inférieur à 0 = l’entreprise se finance elle même et
dispose d’un excédent de ressources.
63
exemple :
BFRNG = 231 000 – 149 600 = 81 400 €
L’entreprise est donc en capacité de se fiancer elle même.
La trésorerie nette
La trésorerie nette permet de connaitre le montant des
disponibilités financières à court terme.
Elle se calcule de cette façon :
Trésorerie nette = FRNG – BFRNG
Exemple :
Trésorerie nette = 124 200 – 81 400 = 42 800 €
Afin d’être sûr de nos résultat du FRNG, BFRNG et de la trésorerie
nette, il suffit de calculer une seconde fois la trésorerie mais de
cette façon :
Trésorerie nette = Actifs de trésorerie – Passifs de trésorerie
Les ratios
Afin de faciliter l’analyse du bilan fonctionnel, il est nécessaire de
calculer plusieurs ratios :
64
Solution à apporter
Selon votre analyse du bilan d’une entreprise, vous pouvez appor-
ter plusieurs solutions selon les difficultés rencontrées :
- Ajuster le FRNG en augmentant les ressources stables (ex: cher-
cher de nouveau investisseur) ou en diminuant les emplois stables
(ex: revendre des machines de production);
- Agir sur le BFRNG en réduisant les stocks, en diminuant les
créances des clients ou en augmentant les dettes fournisseurs.
- Faire appel à un organisme financier pour augmenter la trésorerie
et ainsi financer les dettes à courts termes.
65
Gestion de clientèle
5) Les coûts commerciaux
Coûts directs : tous les coûts que l’on peut avoir sur un produit, un
individu et les actions qu’il mène
Exemples : salaires, charges sociales, frais de déplacement, frais
de relation, frais de formation
Coûts indirects : coûts appliqués à plusieurs produits et actions
Exemple : Soutien de l’activité, coût de l’utilisation de matériel (voi-
ture, stand, publicité sur stand), coûts informatiques (ordinateur,
connexion internet), coûts divers (téléphone, frais de bureau)
Coûts variables : charges qui peuvent varier en fonction de l’acti-
vité
Exemples : achat de marchandises et de matières premières, frais
de port, coûts de production, salaires (commissions) et charges
sociales variables en fonction des ventes
Coûts fixes : charges qui ne varient pas en fonction de l’activité de
l’entreprise. Les coûts fixes sont ceux dépendants des
équipements de l’entreprise
Exemples : les loyers, les intérêts des emprunts, les salaires fixes,
les amortissements
66
Gestion de clientèle
6) La rentabilité
Calcul de l’amortissement :
B = coûts d’acquisition HT – valeur résiduelle
L’amortissement en fonction des avantages économiques se
calcule ainsi : A = B x AAA : AGA
A = amortissement annuel
B = base de l’amortissement (coût d’acquisition HT – valeur rési-
duelle)
AAA = avantage annuel attendu
AGA = avantage global attendu
Tableau d’amortissement d’un véhicule amorti à partir du
01/01/2014 qui est repris par le constructeur automobile 8 ans
après l’utilisation pour une valeur de 3 000 € (valeur résiduelle).
67
Calcul du montant de l’amortissement linéaire :
A=Bxt
A = montant de l’amortissement (annuité)
B = base de l’amortissement (coût d’achat HT – valeur résiduelle
estimée)
t = taux
ex: un véhicule est acheté en Novembre 2014 d’une valeur
de 15 000 €. L’entreprise prévois de l’utiliser sur 5 ans et de le
revendre 2 000 € après l’utilisation (valeur résiduelle).
calcul de l’annuité de 2014 =
(15 000 – 2 000) x 0,20 x (59/360) = 426,11€
0,20 = taux d’amortissement par année (5 ans soit 20 % par an)
59 = nombre de jour d’utilisation avant la fin de l’année
360 = nombre de jour dans l’année
Le taux se calcule donc de la façon suivante : t = 100 / n
exemple : l’entreprise prévoit d’amortir le véhicule sur 5 ans donc
t = 100 / 5 = 20 %
exemple de tableau d’amortissement linéaire :
68
Seuil de rentabilité :
Calcul de la marge sur coût variable :
CA HT – Coûts variables = MSCV
Calcul du résultat : MSCV – Charges fixes = Résultat
Le résultat permet d’établir le compte de résultat (ou compte de
résultat par variabilité) qui trie les coûts par catégorie, montant et
pourcentage.
Voici un exemple de compte de résultat différentiel :
Le résultat peut être positif ou négatif. Si’l est positif c’est que
l’entreprise réalise un bénéfice et dans le cas contraire, une perte.
L’analyse du résultat différentiel permet de trouver le taux de
marge sur coût variable.
Calcul du taux de marge sur coût variable : (MSCV / CA ) x 100
Calcul du seuil de rentabilité :
Le seuil de rentabilité est atteint lorsque la MSCV – coûts fixes = 0
Calcul du seuil de rentabilité à partir du compte
de résultat différentiel : Coûts fixes / TMSCV = SR
Calcul de la transformation du SR en SR en quantité (le nombre de
vente pour atteindre le SR) : SR / PVUHT = SR en quantité
exemple : Le SR d’une entreprise est de 350 000 €. Elle commer-
cialise une formation au professionnel d’un montant de 500 € HT.
350 000 / 500 = 700 ventes minimum pour atteindre le seuil de
rentabilité.
69
Gestion de clientèle
Conseils
Entrez un maximum de formules et de tableau dans votre calcula-
trice avant l’épreuve de MGAC.
Vérifiez les piles de votre calculatrice
N’oubliez pas votre règle pour les tableaux
Donnez la provenance de chaques résultats et de chaques don-
nées utilisées
70